 Une
femme noire à la tête du Canada
Une
femme noire à la tête du Canada
Alors que la question d’un président ou d’un
premier ministre noir en France est loin d’être à
l’ordre du jour, les Canadiens, eux, ont franchi le pas
en septembre 2006 en acceptant en majorité la nomination
d’une femme noire à la tête du pays.
Par Céline Marie-Nely
Publié le 12 juillet 2006
Michaëlle Jean, jeune femme de 49 ans, ancienne immigrante haïtienne
et journaliste très populaire au Québec a donc quitté
les plateaux télé qu’elle occupait depuis
18 ans pour devenir la personnalité politique la plus importante
du pays. Nommée par le premier ministre, elle occupe désormais
le poste de Gouverneure Générale du Canada et commandant
en chef des forces armées canadiennes, la plus ancienne
institution canadienne, dont le but est de promouvoir l’unité
nationale. Le Canada, démocratie parlementaire et monarchie
constitutionnelle, est rattaché à la couronne d’Angleterre
par la personne du Gouverneur général. Il s’agit
donc d’un rôle très prestigieux.

Michaëlle Jean
Michaëlle Jean n’a peut-être pas de pouvoirs décisionnels,
puisqu’ils reviennent au premier ministre, mais elle assume
la fonction d’un chef d’Etat et gardera toute sa vie
le titre de « Très Honorable ». En devenant
la 27e Gouverneur Générale du Canada, elle est aussi
la troisième femme, la première noire et la deuxième
immigrante à accéder à ce poste puisqu’elle
succède à Adrienne Clarkson, d’origine chinoise.
Sa nomination en 2006 est une consécration pour elle, une
fierté pour la communauté noire et un symbole d’espoir
pour toutes les minorités ethniques. C’est la preuve
de la grande ouverture d’esprit des Canadiens et elle-même
le reconnaît : « La grande force de ce pays c’est
qu’il se transforme. Durant toutes ces années où
j’ai œuvré comme journaliste et animatrice,
sur les différentes chaînes de notre télévision
publique, j’ai vu les préjugés reculer et
les mentalités évoluer. Fini le temps où
l’on osait penser et dire qu’une personne de race
noire n’avait aucune crédibilité en information
aux yeux du public. Je viens de loin. Mes ancêtres étaient
des esclaves. Je suis née en Haïti, le pays le plus
pauvre de cet hémisphère. Je suis fille d’exilés
chassés de leur terre natale par un régime dictatorial
». Quel parcours justifie que cette femme, arrivée
au Québec à l’âge de onze ans et qui
n’a jamais fait de politique, ait été choisie
comme symbole actuel de l’identité canadienne ?
Michaëlle Jean ou le modèle d’intégration
à la canadienne
Après une maîtrise en littérature comparée
des langues italienne et hispanique, Michaëlle Jean se destine
à une carrière universitaire puisque dès
la fin de ses études, elle est chargée de cours
à l’université de Montréal. Pourtant,
c’est le milieu associatif qui l’attire et, très
tôt, elle s’engage au Regroupement provincial des
maisons d’hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale au Québec, et travaille
parallèlement dans des organismes d’aides aux femmes
et aux familles immigrantes. Le journalisme vient à elle
presque par hasard. En 1986, Michaëlle Jean retourne en Haïti
dans le cadre d’un documentaire de l’Office national
du film qui suit les premières élections libres
et démocratiques du pays. Diffusé quelques mois
plus tard, « Haïti nous sommes là, Hayti, nous
la en » montre les images marquantes de l’équipe
de tournage attaqué par les macoutes et le professionnalisme
de Michaëlle Jean. Elle est alors repérée par
Radio-Canada, principal groupe audiovisuel francophone du pays
et pendant plusieurs années, elle gravit les échelons
au sein de la rédaction, passant de simple rédactrice
à journaliste incontournable qui réalise ses propres
émissions. Elle anime pendant plus de dix ans des documentaires,
des émissions consacrées aux questions de société
et des émissions d’information comme le Téléjournal
en fin de semaine et l’Heure du Midi. Dès 2001, sa
carrière connaît un second souffle. Michaëlle
Jean se voit chargée de la réalisation de Grands
reportages pour la chaîne internationale de Radio-Canada,
RDI (le Réseau de l’Information) ; elle est aussi
à l’antenne de CBC, concurrent anglophone de Radio-Canada
et présente l’émission The passionate eyes.
La popularité de Michaëlle Jean est immense au Québec,
où la qualité de son travail a été
maintes fois reconnue aussi bien par ses pairs que par l’ensemble
des Québécois. En 1995, elle remporte le prix du
journalisme d’Amnesty International pour la série
La moitié du monde sur les enjeux de la Conférence
Internationale de l’ONU sur les femmes. En 1998, elle est
nommée « femme de l’année » par
le magazine Elle. Et en 2003, Michaëlle Jean est médaillée
de « l’Ordre des chevaliers de la Pléiade des
Parlementaires de la Francophonie » pour la promotion de
la francophonie et du rapprochement des cultures.
Cette ascension remarquable, ajouté au fait qu’elle
parle couramment cinq langues, le français, l’anglais,
l’espagnol, l’italien et le créole haïtien,
est celle d’une femme qui a toutes les compétences
et le charisme requis pour accomplir son rôle dignement.
Comment expliquer pourtant que sa nomination fut suivie d’une
campagne de diffamation au Québec ? L’histoire et
l’identité canadiennes sont compliquées et
si Michaëlle Jean a pu faire l’objet de critiques,
ce n’est pas pour l’ancienne immigrante haïtienne
qu’elle était, mais au contraire pour la Québécoise
qu’elle est devenue. Soupçonnée d’avoir
des sympathies indépendantistes, avec son mari le cinéaste
Jean-Daniel Lafond, Michaëlle Jean doit maintenant prouver
qu’elle œuvre au rassemblement de tous les Canadiens,
français, anglais et d’origine étrangère.
Le Canada, terre d’exil idéale ?
Sans connaître forcément l’histoire de Michaëlle
Jean, les jeunes Noirs français sont de plus en plus convaincus
du modèle de réussite à la canadienne et
chaque année, nombreux sont ceux qui décident de
franchir l’Atlantique en quête d’une société
meilleure. Même si cette migration ne représente
en elle-même qu’une très faible proportion,
le désir de quitter la France est de plus en plus fort.
A mesure que la France déçoit, le Canada attire
: si on rejoint le Canada, c’est bien pour aller y trouver
ce que la France ne nous offre pas et même, nous refuse.
Ces jeunes, qui entrent dans la vie active, pensent parfois qu’en
France, chômage et sous-emploi sont souvent liés
à la discrimination et que l’Etat est trop peu engagé
dans les luttes contre le racisme et les discriminations. Certains
choisissent la Grande-Bretagne pour sa proximité, d’autres
le Canada pour sa francophonie, mais au fond, tous sont à
la recherche d’une société multiethnique et
multiculturelle dans laquelle ils pensent pouvoir facilement s’intégrer
sans être montrés du doigt. En effet, société
multiculturelle signifie absence de modèle culturel unique
et cohabitation de cultures différentes. La France a peut-être
derrière elle une longue tradition de terre d’accueil
et d’asile, mais elle manifeste encore un blocage culturel
face au danger potentiel que pourrait représenter la valorisation
d’une autre culture, autre que strictement européenne.
Il n’est donc pas étonnant que beaucoup se tournent
vers le Canada, terrain d’expérimentation du multiculturalisme
depuis trente ans et plusieurs fois élu pays où
il fait le mieux vivre au monde. Par contraste avec ce qu’il
avait vécu en France, un jeune d’origine tchadienne
soulignait sa surprise d’entendre des Canadiens l’accueillir
en lui disant « Bienvenu au Québec ». Il est
vrai qu’au Canada, on n’envisage pas seulement «
l’intégration » comme une injonction faite
aux populations qui entrent dans le pays. Aux antipodes des responsables
français, qui n’ont de cesse de stigmatiser la volonté
d’intégration des migrants, le gouvernement canadien
prévoit de fournir une formation à la « population
d’accueil » afin qu’elle comprenne mieux la
culture de ceux qui arrivent et soit ainsi mieux à même
de les accueillir.
Une mosaïque ethnique

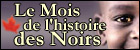
Bannières internet
Parce qu’elle est née du mélange des populations
autochtones, françaises et anglaises et qu’elle est
depuis toujours un pays d’immigration, la société
canadienne a la réputation d’être extrêmement
ouverte à la diversité. Elle est passée,
au cours des années 1960, du biculturalisme franco-anglais
au multiculturalisme. Le recensement de 2001 montre que parmi
les 30 millions de personnes résidant au Canada, 18,4%
sont nées à l’étranger, soit près
d’une personne sur cinq. Cette immigration en direction
du Canada ne cesse d’augmenter. Elle vient d’atteindre
son plus haut niveau depuis 70 ans. Alors que l’immigration
était traditionnellement européenne, les nouveaux
visages des migrants canadiens sont asiatiques, africains, latinos
et caribéens. On compte aujourd’hui plus de 200 origines
ethniques différentes et la Chine arrive en tête
des pays de naissance des immigrants des années 1990. Avec
un étudiant sur dix venant d’un pays étranger,
l’université de Montréal est l’une des
plus cosmopolites au monde. Plus de 140 pays différents
y sont représentés et un quart des étudiants
étrangers sont africains. Parmi eux, un grand nombre de
Marocains, beaucoup de Camerounais, d’Ivoiriens, de Gabonais,
de Sénégalais. Le pays connaît actuellement
son plus fort taux de naturalisation. Cela prouve que, pour les
nouveaux canadiens nés à l’étranger,
acquérir la citoyenneté canadienne n’est pas
vu comme un renoncement à leur patrimoine culturel ou comme
une assimilation aveugle à la culture du Canada. Il n’y
a pas à choisir. L’Etat canadien valorise aussi bien
les cultures de souche française et anglaise que toutes
les autres cultures présentes sur son sol. Cette reconnaissance
et ce respect des différences facilitent l’intégration
dans la société d’accueil. En 1991, une enquête
montre que les Canadiens s’identifient d’abord comme
Canadiens plutôt qu’à leurs groupes ethniques
d’origine. A l’inverse, soumis à l’injonction
d’intégration, conçue comme un effacement
de toute singularité, nombre de jeunes Français
accentuent par réaction leur origine et se revendiquent
seulement « maliens » ou « algériens
». On obtient le résultat inverse de celui recherché.
La loi sur le multiculturalisme canadien
En 1971, le Canada innove. A une époque où certains
pays occidentaux sont dépassés pas les nouvelles
vagues d’immigration venus d’Asie et d’Afrique,
notamment en France où des milliers de nouveaux venus sont
entassés dans des bidonvilles faute de place, le Canada,
lui, a trouvé le moyen d’anticiper sur les conditions
d’intégration de ses migrants et futurs migrants.
Bien que lui-même confronté à des crispations
identitaires autour de la question de l’indépendance
de la province du Québec, le Canada met en place un cadre
juridique nouveau qui assure à tous les mêmes droits
et la même protection. L’esprit multiculturel du pays
se concrétise en 1988 lorsque est instituée la loi
sur le multiculturalisme. Plus qu’une loi, elle apparaît
alors comme un véritable choix de société,
un pacte collectif dont le bon fonctionnement dépend de
la participation entière de chaque citoyen canadien. Après
des années de doute et d’incertitude sur son identité,
déchirée par l’affrontement franco-anglais,
le Canada a décidé de faire de sa faiblesse le socle
de son identité. Le respect de la différence est
devenu son projet de société. La loi sur le multiculturalisme
rappelle les valeurs premières de liberté et d’égalité
entre les citoyens. Elle reconnaît que, « indépendamment
de toute discrimination, […] chacun a la liberté
de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d'opinion,
d'expression, de réunion pacifique et d'association, […]
elle garantit également aux personnes des deux sexes ce
droit et ces libertés ». La lutte contre les discriminations
est au cœur de cette loi : « Les personnes appartenant
à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique
ne peuvent être privées du droit d'avoir leur propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion,
ou d'employer leur propre langue ». Mais elle reconnaît
surtout « à tous la même protection, tout en
faisant cas des particularités de chacun ». Le projet
poursuivi est donc celui de l’unité dans la diversité,
du respect de l’identité de chacun à travers
la valorisation du patrimoine multiculturel du Canada.
Le multiculturalisme canadien est un projet d’avenir. Il
s’appuie sur des fondements de l’histoire canadienne,
comme le statut des deux langues officielles du pays, et les droits
spécifiques des peuples autochtones du Canada, mais il
reconnaît aussi la diversité de la population comme
une richesse inestimable. Les migrants et anciens migrants constituent
un formidable réservoir de langues étrangères.
Le chinois, le pendjabi et l’arabe sont les trois langues
les plus parlées au Canada après l’anglais
et le français.
La loi sur le multiculturalisme est une base législative
qui encourage des projets visant à la compréhension
interculturelle. Chaque moment de l’année est rythmé
par des campagnes de sensibilisation. Février est le mois
de l’histoire des Noirs, mai celui du patrimoine asiatique
et, le 27 juin, a été célébrée,
comme chaque année depuis deux ans, la journée canadienne
du multiculturalisme. Les festivals et de fêtes célébrant
la diversité sont l’occasion de rencontres et de
ferveur nationale commune.
Les défis de la diversité
A l’inverse de la France, définir le profil ethnoculturel
du Canada par des statistiques n’est pas un tabou. Il est
considéré comme l’instrument nécessaire
pour former une société toujours plus égalitaire.
Depuis la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, on utilise communément le terme de «
minorités visibles » pour définir «
les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de
race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Les
groupes minoritaires visibles qui sont d’abord chinois,
sud-asiatiques et noirs, représentent aujourd’hui
13,4% de la population canadienne et sont en augmentation constante.
Une politique d’action positive en faveur de la diversité
est menée. Le projet « l’argent n’a pas
de couleur » vise à éradiquer les préjugés
sur les habitudes de consommation des minorités visibles
et à diversifier le secteur de la publicité aussi
bien dans les coulisses du métier que dans les spots et
affiches. Un autre projet est de définir les profils démographiques
des communautés noires au Canada, tâche extrêmement
compliquée quand on sait qu’aux descendants des premiers
Noirs installés sur le sol canadien depuis des siècles,
il faut ajouter les diasporas noires caribéennes et africaines.
Le défi canadien est celui de la diversité envisagée
à plusieurs échelles : diversité entre groupes
ethniques, diversité au sein même de ces groupes
et diversité de l’identité canadienne.

