 Diversité
linguistique et connaissance Diversité
linguistique et connaissance
Le travail présenté ici est un
résumé synthétique d’un article {1}
que le lecteur pourra consulter pour plus d’information.
Nous tentons d’analyser la « dynamique » de
la diversité linguistique et de mettre en évidence
les limites du monolinguisme et l’attention nécessaire
aux relations entre les langues de production et de diffusion
du savoir.
Jean-Pierre Asselin de Beauville et Patrick Chardenet
Agence universitaire de la Francophonie
Publié le 1er septembre 2006
Il y va d’abord d’un constat : on ne peut soumettre
le développement scientifique, qui a besoin d’un
temps propre à lui, à une langue qui doit en partie
sa position hyperdominante à sa capacité à
représenter l’accélération du monde
et qui ne résistera pas forcément à la même
durée. Si un résumé, un compte rendu ou une
note peuvent être calibrés dans une seule langue
hypercentrale aux fins de valorisation d’un article, d’une
communication, il semble difficile, voire contre-productif de
réduire une relation d’expérience, une description
de recherche fondées sur des orientations épistémologiques
définies à travers des notions et concepts précis,
ou un développement théorique argumentatif, dans
un idiome qui jouerait le rôle de référent
mondial de la science. Il faut encourager les traductions et l’interprétariat
scientifiques en améliorant les formations spécialisées,
en contribuant au développement d’outils d’assistance
de traitement de la parole et de l’écrit, la recherche
sur le langage et les langues devant contribuer à en améliorer
la qualité. Mais la production, l’acte initial fondateur
du savoir est lui-même un langage. Dans l’ouvrage
Le Vocabulaire européen des philosophie -Dictionnaire des
intraduisibles {2} , les auteurs se démarquent
aussi bien d’une dynamique inévitable du tout anglo-américain
mondial, fondée sur l’illusion que cette langue pourrait
rendre compte aussi bien de la physique, de l’informatique,
de la biologie aujourd’hui et pour demain, et parallèlement
d’une philosophie relevant d’un universel logique,
identique en tous temps et en tous lieux, que
d’une représentation qui reposerait sur l’idée
qu’une langue comme l’allemand puisse être ‘la’
langue philosophique par excellence et dont les concepts seraient
intraduisibles dans d’autres langues {3}
. Dans un article paru dans Pour la Science {4}
, Laurent Lafforgue affirme que “ c’est dans la mesure
où l’école mathématique française
reste attachée au français qu’elle conserve
son originalité et sa force. A contrario, les faiblesses
de la France dans certaines disciplines scientifiques pourraient
être liées au délaissement linguistique ”.
Plus loin, il ajoute : “ La créativité scientifique
est enracinée dans la culture, dans toutes ses dimensions
– linguistique et littéraire, philosophique, religieuse
même… Alors, gardons la diversité linguistique
et culturelle dont se nourrit la science. ”.
On peut supposer qu’à l’origine
de l’humanité, le petit groupe de nos premiers ancêtres
communiquait à l’aide d’un langage adapté
à leur situation. Cependant le langage n’est pas
un don, il apparaît avec sa nécessité. Les
langues actuelles seraient donc toutes issues moins d’un
proto-langage que d’une même nécessité
de communiquer pour organiser le groupe, qui se serait progressivement
diversifiée par la suite des acculturations {5}
diverses accompagnant les migrations géographiques et les
évolutions biologiques des êtres humains. L’hypothèse
selon laquelle l’homme ne serait pas apparu en un seul lieu
mais en différents lieux ne change pas la nature du processus
imaginé ici puisqu’il suffirait alors d’en
imaginer autant en parallèle.
En ce qui concerne les mécanismes qui nous paraissent gouverner
la diversité linguistique, on pourrait dire qu’il
existe une double étape dans la galaxie linguistique :
une extrême différentiation des langues par acculturation,
c’est-à-dire par adaptation à une culture
évolutive dans le temps et l’espace, et une extrême
attraction vers le monolinguisme des messages portés par
la technologie, congruente à l’accélération
(temps) et à l’extension (espace monde). Ce processus
de différentiation de la variation dialectale à
la créolisation est en outre rendu plus complexe par le
phénomène de l’amplification des contacts
de langues et de leurs effets sur les langues (emprunts, créolisation,
porteurs de nouvelles langues à l’interface de celles
existantes) et sur les individus (alternances, mélanges
de langues).
Faut-il voir dans ce processus de métissage
des langues associé aux effets de la mondialisation économique,
un extraordinaire et redoutable accélérateur qui
tend à imposer au monde une lingua franca, un phénomène
pouvant, à long terme, conduire à la disparition
de la diversité linguistique ? La réponse à
cette question est certes difficile, cependant on peut observer
que si, depuis l’origine de l’humanité, un
grand nombre de langues et de cultures ont disparu (souvent pour
d’autres raisons que le métissage, notamment par
l’absence de contacts), nous n’en sommes toujours
pas arrivés à une situation d’uniformité
et que d’autre part, l’interculturation {6}
et l’interlinguisme ont favorisé des partenariats
productifs. Comme le fait justement remarquer Michèle Gendreau-Massaloux
{7} , “ si l’on insiste beaucoup
sur la ‘mort’ des langues, personne
ne fait allusion à la ‘naissance’ de
nouvelles langues dont témoignent pourtant de nombreux
travaux de terrain ”, jusqu’aux hypothèses
de fusions linguistiques entre langues proches qui ne relèvent
pas de la disparition mais plutôt de la co-création
{8} . On peut aussi observer que de ‘petites
langues’ {9} sont plus présentes
au monde qu’elles ne l’étaient il y a une cinquantaine
d’années comme par exemple le créole des Antilles
françaises pour lequel le métissage s’est
plutôt accompagné d’un certain renforcement
de l’emploi de la langue.
Il devient alors possible d’imaginer
un processus génératif des langues susceptible de
garantir le maintien d’un principe fonctionnel de diversité
car “ même dans des régions du monde où
l’attirance de grandes langues de communication internationale
peut faire concurrence aux langues locales, des mouvements de
création se produisent, qui témoignent d’un
essor de variétés linguistiques nouvelles ”
{10} . S’il en est ainsi, on devrait être
en mesure d’affirmer que toute tentative pour une langue
de s’imposer au monde comme langue de communication universelle
est vouée à l’échec, du fait de la
tendance naturelle de l’Homme à construire de la
complexité, à bâtir des paradigmes même
lorsqu’il affiche rechercher un objectif général
de communication sans contrainte. La diversité serait en
quelque sorte, inscrite dans l’évolution
de l’humanité, comme une sorte de protection fondamentale.
“ La fin des distances physiques révèle l’importance
des distances culturelles. Plus il y a de communication, d’échanges,
d’interaction, et donc de mobilité, plus il y a,
simultanément, un besoin d’identité ”
{11} qui favorise un accès global au
sens par un élargissement de ses composantes. La thèse
de cette « diversité fondamentale » se trouve
d’ailleurs soutenue par l’observation de la diversification
progressive des langages informatiques ou encore par celle des
langues artificielles, ce qui indique une tendance sur le long
terme, de recherche de diversification linguistique, ce qui implique
que sur des échelles de temps plus courtes, perdure suffisamment
d’hétérogénéité culturelle
afin de pouvoir nourrir de façon permanente le processus
de diversification. À cette dernière échelle
de temps, qui correspond globalement à la durée
de quelques vies humaines, il est donc important de prendre des
mesures de mise en valeur des cultures locales et régionales,
dans chaque pays, pour que le processus de mise au monde de la
diversité culturelle et linguistique à long terme
puisse se poursuivre.
Que pouvons nous faire pour cela ? C’est
d’abord et avant tout l’intégration de la connaissance
dans sa culture de production qu’il faut valoriser, si l’on
souhaite que la ou les langues attachée(s) à cette
culture reste dynamique, créative et se développe,
voire fusionne avec d’autres langues pour en produire de
nouvelles. Il nous semble erroné de mettre en exergue la
défense d’une langue tout en n’accordant pas
assez d’importance au développement culturel. {12}
D’évidence la réciproque s’impose, a
contrario une langue qui serait confrontée à une
autre langue dominante et qui ne serait pas « supportée
» par suffisamment de productions culturelles serait menacée
à terme de disparition. La disparition du latin, est ainsi
un exemple de création de langues (les langues romanes)
par fusions. Ce processus progressif (jusqu’en 1906, les
thèses de Lettres en France étaient soutenues en
latin) n’est pas le simple fait d’une simple décision
politique (comme celle de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts
en 1539) ou des marchés dominants, mais le résultat
de l’enrichissement du fonds latin et de son adaptation
dans des contextes culturels dynamiques variables. La production
d’œuvres culturelles dans la langue associée
à une culture joue donc à nos yeux un rôle
fondamental pour qu’une langue puisse contribuer au développement.
La culture scientifique étant surtout le fait des universitaires,
des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens, leur
participation à la promotion de la langue et, en conséquence,
de la diversité culturelle et linguistique est une clé
de la réussite en ce domaine. Cependant, on comprendra
aisément que si ces scientifiques et universitaires choisissent
(comme cela est souvent le cas actuellement) de produire uniquement
leurs œuvres dans une langue qui n’est pas celle attachée
à leur profonde culture de production mais celle d’une
simple culture de diffusion, leur langue d’origine, celle
dans laquelle leurs compétences ont été acquises
dans un contexte spécifique de culture éducative,
se trouvera menacée de dégradation et de disparition.
C’est ainsi que lorsque les chercheurs francophones, par
exemple, se soumettent à cette culture de diffusion en
produisant directement et en publiant uniquement dans la langue
hyperdominante, ils contribuent, qu’ils le veuillent ou
non, à l’affaiblissement de leur langue et de leur
culture éducative. Plus on produira de contenus culturels
et scientifiques en français et mieux la langue française
pourra contribuer au développement avec les autres langues
du monde. Cela paraît une évidence
et pourtant cette simple idée n’est pas acceptée
par de nombreux francophones universitaires ou non. L’aveuglement
du marché les rend objectivement complices de la perte
à terme, de la contribution de la langue française
au monde. Dire cela implique la mise en place de politiques linguistiques
adaptées, en particulier, dans le monde universitaire {13}
.
|1| JP Asselin de Beauville,
P Chardenet, « Quelle dynamique pour la diversité
linguistique ? », Revue Riveneuve-Continents, n°3, novembre
2005.
|2| Cassin, B., 2004, Le Vocabulaire
européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles,
Paris, Le Seuil/Le Robert, 2004, 1532 pages.
|3| Cheymol, M., 2004, note de lecture
dans Le français à l’Université;, 4-2004,
Agence universitaire de la Francophonie, p.5.
|4| “ Le français
au service des sciences ”, dans Pour la Science, mars 2005.
|5| tNous adoptons ici cette
notion selon la définition du Memorandum du Social
Science Research Council comme: « L'ensemble des phénomènes
résultant du contact direct et continu entre des groupes
d'individus de cultures différentes avec des changements
subséquents dans les types de culture originaux de l'un
ou des autres groupes.» Bastide (R), 1998, Acculturation,
dans Encyclopedia Universalis, 1-114 c et suivant.
|6| Demorgon, J., 2000, L’interculturation
du monde, Anthropos.
|7| 2004, “ Les langues,
ni anges, ni démons ”, Hermès n° 40, Francophonie
et mondialisation, éditions du CNRS.e
|8| Comme en témoignent
des relevés en zones frontalières.
|9| En nombre de locuteurs.
|10| Gendreau-Massaloux, M., 2004, Ibid, pp. 275-279
|11| Wolton, D., 2003, L’autre
mondialisation, Flammarion
|12| JC Beacco, M. Byram, « Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe – De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue », Conseil de l’Europe, Strasbourg (France), avril 2003, p. 137.
|13| JP Asselin de Beauville,
P Chardenet, « La diversité linguistique dans la
production et la diffusion du savoir : constats et propositions
», IIIe. Séminaire interaméricain sur la gestion
des langues-« Les politiques linguistiques au sein des Amériques
dans un monde multipolaire », Rio de Janeiro, 29-31 mai
2006.
Jean-Pierre Asselin de Beauville
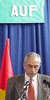 Jean-Pierre
Asselin de Beauville est professeur d’informatique à
l’Université François Rabelais (Tours) où
il a dirigé le laboratoire d’informatique et crée
l’équipe “ Reconnaissance des formes et analyse
d’images ”. Depuis 1998, il est détaché
comme vice-recteur aux programmes à l’Agence universitaire
de la Francophonie, à Montréal
Patrick Chardenet
 Patrick
Chardenet est maître de conférences en sciences du
langage à l’Université de Franche-Comté
(Besançon). Depuis 2005, il est détaché comme
chef de projet dans le cadre du programme “ Langue française,
francophonie et diversité linguistique ” auprès
de l’Agence universitaire de la Francophonie
|

