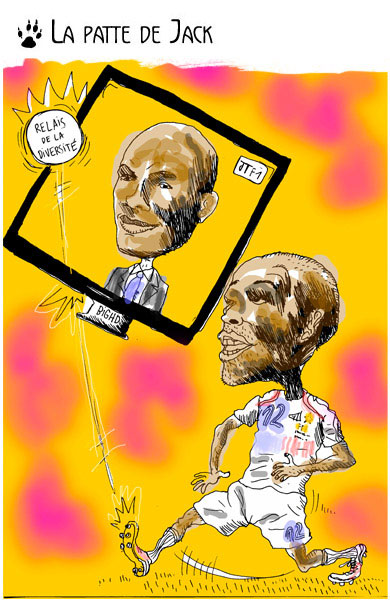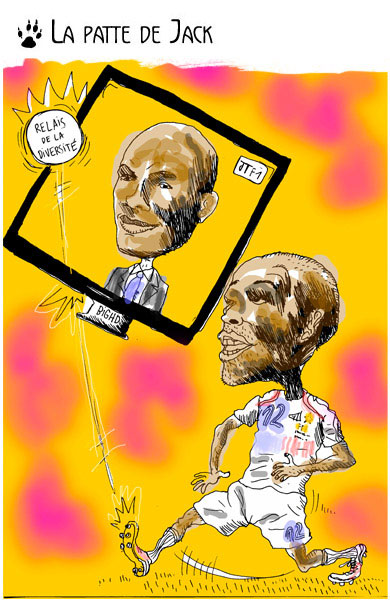Publié le 20 septembre 2006
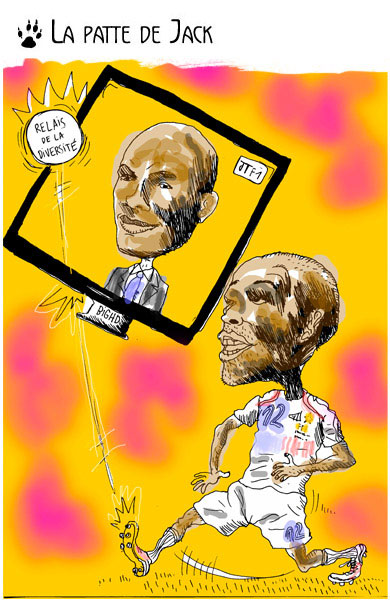
 De
Henry à Harry
De
Henry à Harry
« Parce qu’on est plusieurs à regarder un jeu,
on croit que c’est plus qu’un jeu. Le geste de Zidane,
c’est l’intrusion de la lourde réalité
dans le jeu.»
Dany Laferrière
Suite à la coupe du monde de football, le sénateur
italien Roberto Calderoli déclarait : « La victoire
de Berlin est une victoire de notre identité […]
qui a gagné contre une équipe qui a sacrifié
sa propre identité en alignant des noirs, des islamistes
et des communistes pour obtenir des résultats ».
Peu de responsables politiques français se sont scandalisés
de ces propos. Faut-il s’en étonner ? Il aurait fallu,
pour défendre cette équipe comme elle le méritait,
l’aimer non pas pour ses victoires, mais pour ce qu’elle
représentait. Il aurait fallu être fier de ce que
nous sommes, pour pouvoir répondre au leader populiste
: « Nous n’avons pas renoncé à notre
identité. Cette équipe, c’est notre identité
! ». Au lieu de cela, on pouvait entendre certains intellectuels
français stigmatiser une équipe « black-black-black
»… C’était pourtant cette équipe-là
qui, un mois durant, avait redonné aux Français
le désir d’être ensemble… Puisqu’il
faut trouver un sens aux événements les plus aléatoires,
la défaite en finale semblait dire : le foot a beaucoup
fait, mais il ne peut pas tout. Après le sport, c’est
au reste de la société de prendre le relais de la
diversité : médias, représentation politique,
corps professoral des grandes écoles et des universités,
etc. Le 17 juillet 2006, une semaine après la finale, dont
Thierry Henry était l’un des principaux acteurs,
un autre Antillais - Harry Roselmack - devenait pour l’été
le présentateur du Journal télévisé
le plus regardé d’Europe.
Des progrès, donc… mais très ténus.
Bientôt un an après les émeutes urbaines.
Et les familles antillaises ne peuvent toujours pas louer un logement
dans Paris à leurs enfants, parce que les propriétaires
n’acceptent pas qu’elles se portent garantes («
trop loin… »). Un universitaire d’origine africaine
ne peut toujours pas se marier parce que l’administration,
craignant les mariages « blancs », a rendu quasi impossible
les mariages mixtes… Comme l’affirme Achille Mbembé,
« le racisme à la française consiste à
nier et à refouler la réalité du racisme
tout court de telle manière que l’on puisse commettre
des actes racistes tout en ne les reconnaissant jamais comme tels
». Car les blocages sont enracinés dans les principes
auxquels les Français sont les plus attachés : l’égalité,
la République… Toute nomination d’un «
non-Blanc » – on l’a constaté pour Harry
– est aujourd’hui suspecte d’être une
« discrimination à l’envers ». La marge
est pourtant assez grande pour que tenter de réduire les
discriminations qui pèsent sur les minorités ne
s’apparente à un traitement de faveur à leur
égard… Nous continuons à imposer aux citoyens
des choix exclusifs - êtes vous Français ou Noir
? Français ou Martiniquais ? Français ou Musulman
? Français ou Bourguignon ?- , ne comprenant pas l’atout
que constituerait cette capacité à assumer plusieurs
identités. Comme ces enfants de 1998 qui portaient ensemble
les drapeaux algériens et français. Nous nous en
prenons à ceux d’entre nous qui, venus d’ailleurs,
seraient les mieux à même de faire dialoguer notre
société avec le reste du monde. Ne comprenant pas
qu’en rejetant l’autre, nous ne faisons que nous refuser
nous-mêmes. En organisant la chasse aux « enfants
sans-papiers », la France se prive de la meilleure partie
d’elle-même, celle qui, demain, serait le mieux à
même de répondre aux défis de la globalisation.
François Durpaire, 20 septembre 2006